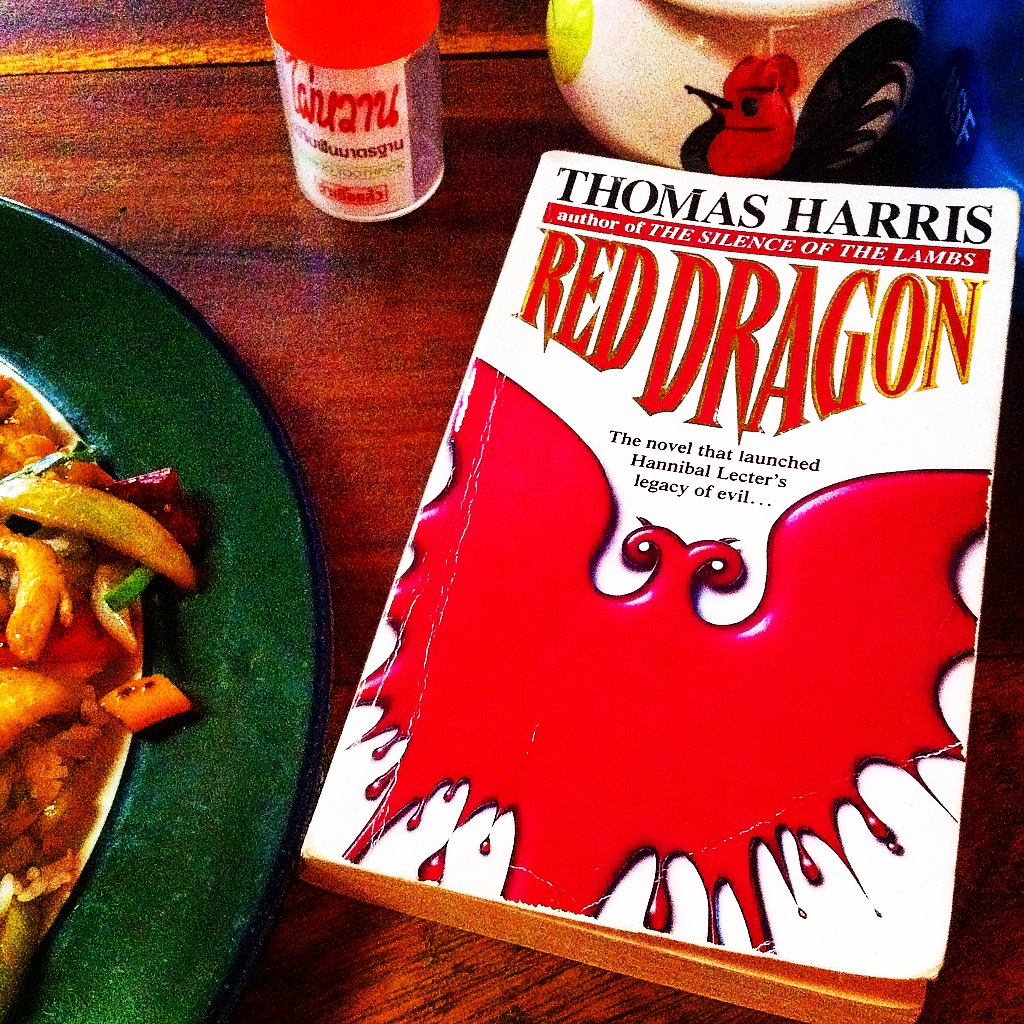Nord-Est de l’Espagne en janvier 1939. La guerre civile qui a ravagé le pays depuis près de trois ans vit ses dernières semaines. La République est sur le point d’être défaite et de laisser la place à quarante obscures années de franquisme. Un soldat républicain laisse s’échapper un prisonnier fasciste, une figure de la Phalange espagnole, Rafael Sánchez Mazas. Celui-ci survit dans les bois, avec l’aide de paysans plutôt favorables à la République. Il rallie Franco et devient un notable de la dictature.
Soixante ans plus tard, le narrateur/auteur écrit un roman sur cet épisode et se met à la recherche du soldat « sauveur » inconnu. Le retrouvera-t-il ? Le chemin passe par Blanes et Roberto Bolaño, une musique de paso doble, Dijon, la Légion étrangère pendant la Seconde Guerre mondiale et quelques longues heures de train.
Ce livre est remarquable et à lire absolument. Avec parfois des facilités d’auto-mises en scène un chouïa agaçantes, Cercas revendique pour l’héritage républicain la place qui lui est due dans l’histoire de l’Espagne. A sa sortie en 2001, plus de 20 ans après le retour de la démocratie, ce roman a rencontré un public important dans ce pays. Beaucoup y ont vu certainement un moyen de réclamer enfin avec fierté d’avoir été du « mauvais » côté sous la dictature franquiste. Intelligemment construit, ce roman mêle la réalité et la fiction. Il démontre l’importance et l’honneur qu’il y a à mener des guerres pour la démocratie et la liberté, même quand elles sont perdues d’avance.
L’auteur raconte dans son roman comment la rencontre avec Roberto Bolaño le lance sur la piste du soldat inconnu. Roberto Bolaño est un auteur chilien, auteur de nombreux romans. Parmi ceux-ci, 2666 est considéré par beaucoup comme le meilleur roman de la littérature hispanophone.
Soldats de Salamine a inspiré un film réalisé par David Trueba, sorti en 2003: la bande-annonce est ici.
Soldados de Salamina, de Javier CERCAS.
Publié en 2016, par Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, España.
Publié en français par Actes Sud.
8 ans dans la pile d’attente.
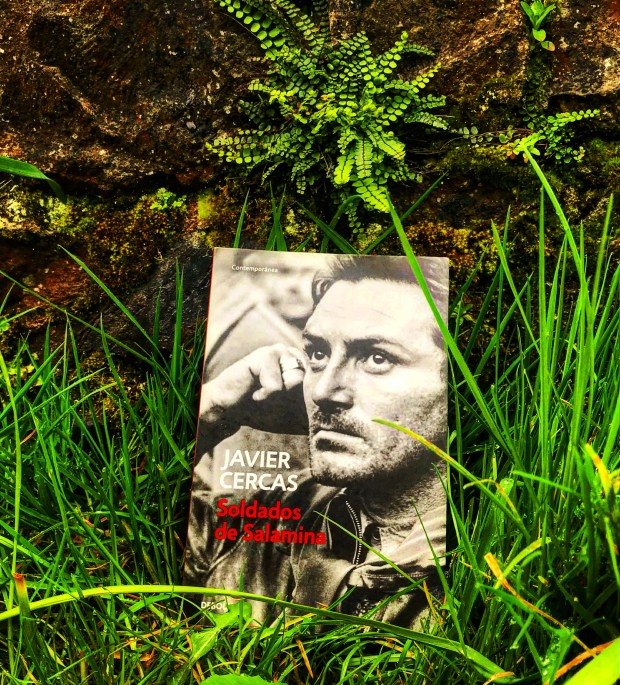
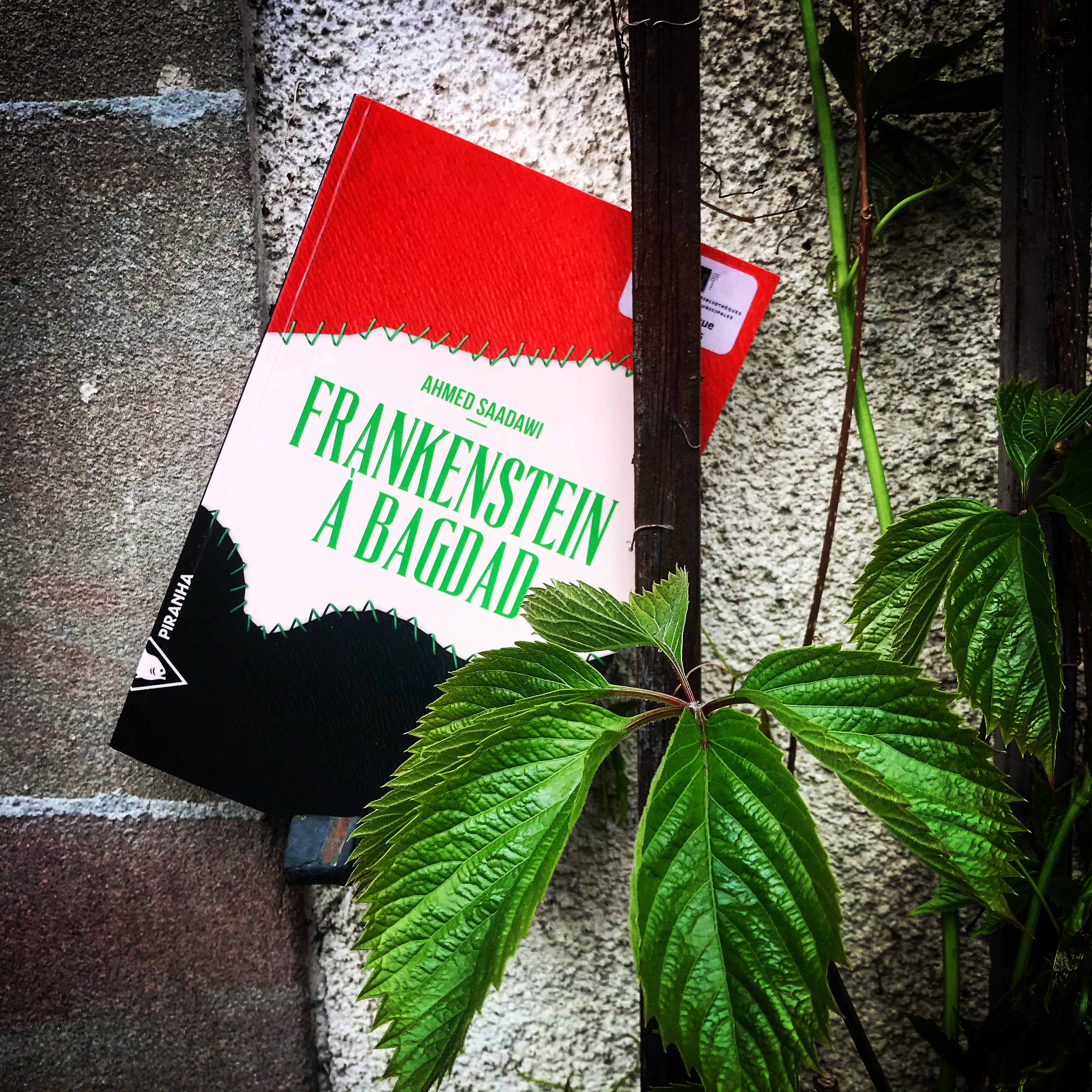
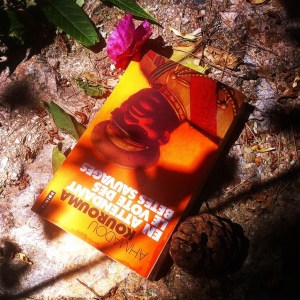 pouvoir, le fil conducteur est représenté par Koyaga, un dictateur bénéficiant d’une baraka lui permettant de déjouer toutes les tentatives d’assassinats et de coups d’état ourdies à son encontre. Tirant force de ses pouvoirs animistes, Koyaga écarte impitoyablement le moindre élément ou la moindre personne qui se met en travers de sa route. Si il s’agit d’un homme celui-ci est régulièrement tué avant ou après avoir été soigneusement émasculé.
pouvoir, le fil conducteur est représenté par Koyaga, un dictateur bénéficiant d’une baraka lui permettant de déjouer toutes les tentatives d’assassinats et de coups d’état ourdies à son encontre. Tirant force de ses pouvoirs animistes, Koyaga écarte impitoyablement le moindre élément ou la moindre personne qui se met en travers de sa route. Si il s’agit d’un homme celui-ci est régulièrement tué avant ou après avoir été soigneusement émasculé.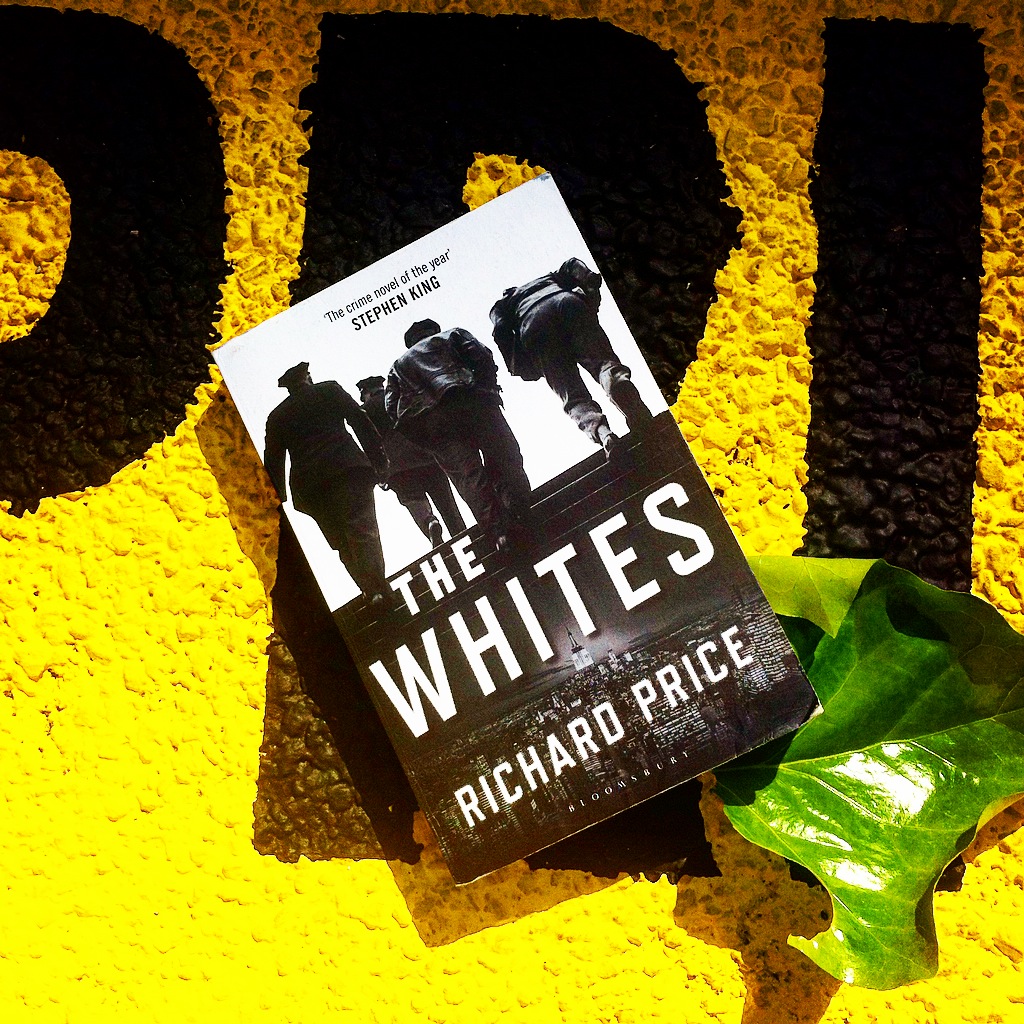 procédure, soit parce que le meurtrier est particulièrement malin. Les flics doivent donc supporter de voir leur proie vaquer tranquillement à ses occupations, sans être inquiétée.
procédure, soit parce que le meurtrier est particulièrement malin. Les flics doivent donc supporter de voir leur proie vaquer tranquillement à ses occupations, sans être inquiétée. gouvernement dirigé par des communistes, tendance léniniste. Il y a la tante, la grand-mère et sa fille Ammu, la mère de « faux » jumeaux ainsi que son fils Chacko, qui a repris la petite entreprise de conserves et produits épicés. Ce microcosme, évoqués par petites touches assez drôles, se prépare à recevoir l’ex-femme de Chacko ainsi que sa fille, débarquées fraîchement de Londres. Le drame se noue autour du passage par des enfants d’une rivière grossie par les pluies, la passion entre Ammu et Velutha, un des employés de l’entreprise, de la caste des Dalits (intouchables) et de tensions entre les patrons et « les masses ».
gouvernement dirigé par des communistes, tendance léniniste. Il y a la tante, la grand-mère et sa fille Ammu, la mère de « faux » jumeaux ainsi que son fils Chacko, qui a repris la petite entreprise de conserves et produits épicés. Ce microcosme, évoqués par petites touches assez drôles, se prépare à recevoir l’ex-femme de Chacko ainsi que sa fille, débarquées fraîchement de Londres. Le drame se noue autour du passage par des enfants d’une rivière grossie par les pluies, la passion entre Ammu et Velutha, un des employés de l’entreprise, de la caste des Dalits (intouchables) et de tensions entre les patrons et « les masses ».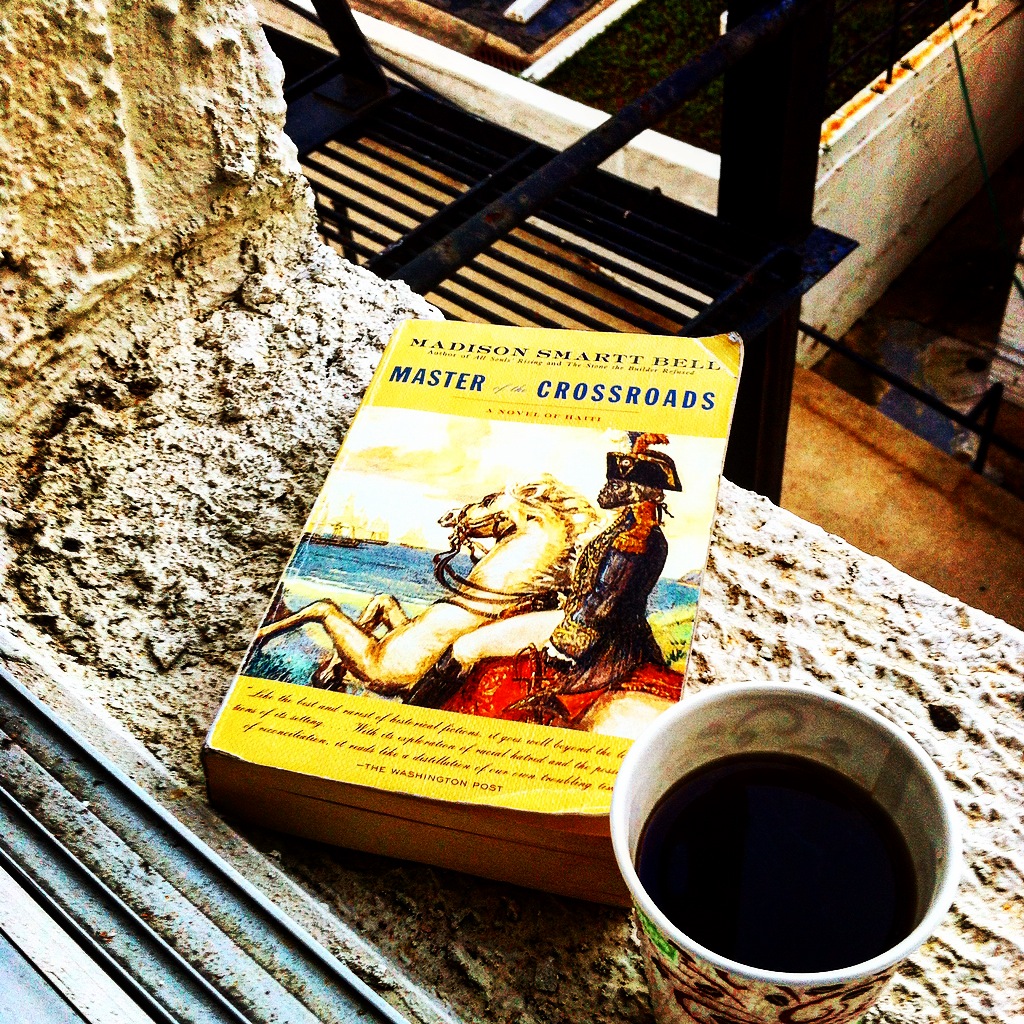 0 par ce fin tacticien toujours sous-estimé par ses adversaires blancs. Parfaitement adaptée aux circonstances compliquées de la naissance d’Haïti, la guerre en mouvement implique aussi le renversement des alliances. Entre les Anglais, les Espagnols, les Français à l’agenda trouble, les créoles et ses propres lieutenants qui deviennent des concurrents, Toussaint danse en permanence, s’alliant pragmatiquement aux uns et aux autres. Cette versatilité apparente cache cependant un objectif clair et inébranlable : l’indépendance d’Haïti et la fin de l’esclavage.
0 par ce fin tacticien toujours sous-estimé par ses adversaires blancs. Parfaitement adaptée aux circonstances compliquées de la naissance d’Haïti, la guerre en mouvement implique aussi le renversement des alliances. Entre les Anglais, les Espagnols, les Français à l’agenda trouble, les créoles et ses propres lieutenants qui deviennent des concurrents, Toussaint danse en permanence, s’alliant pragmatiquement aux uns et aux autres. Cette versatilité apparente cache cependant un objectif clair et inébranlable : l’indépendance d’Haïti et la fin de l’esclavage.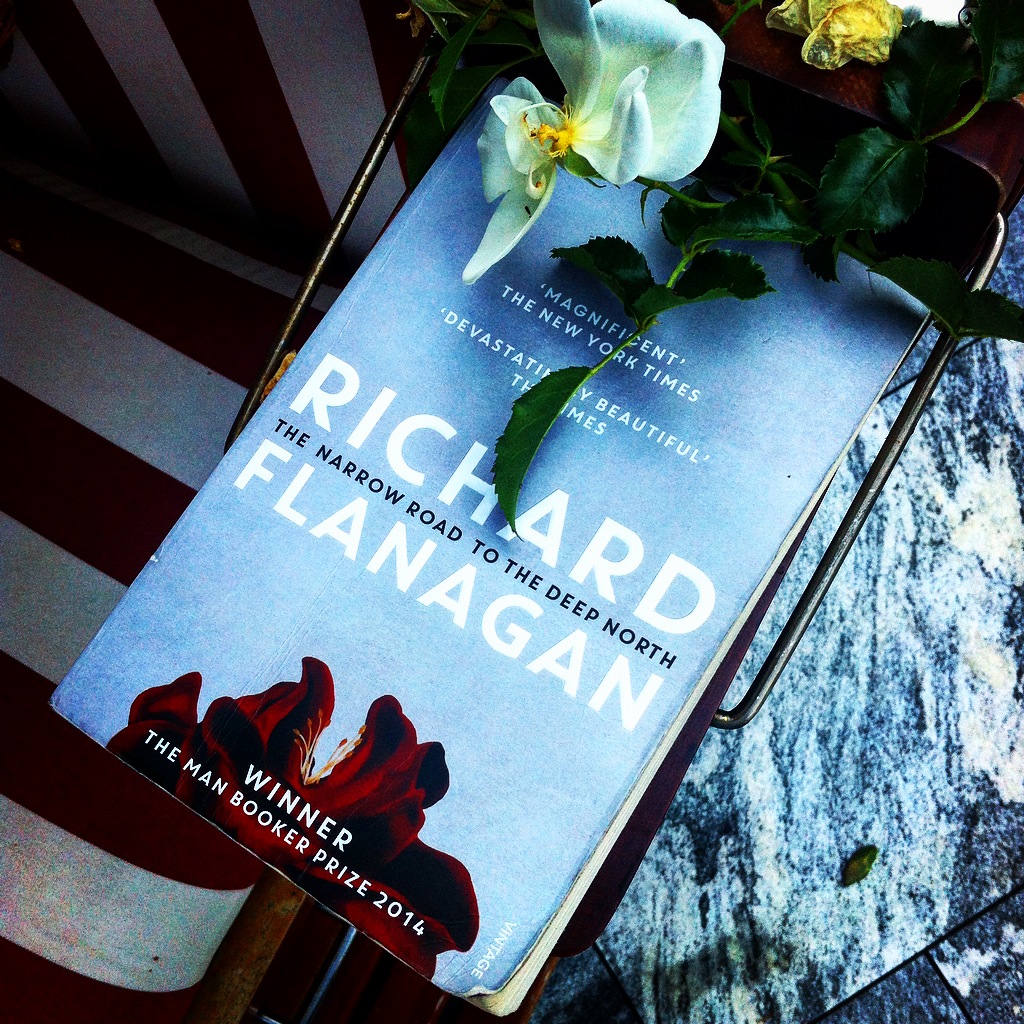 australiens sur le chantier absurde d’une ligne ferroviaire devant relier Bangkok à la Birmanie.
australiens sur le chantier absurde d’une ligne ferroviaire devant relier Bangkok à la Birmanie.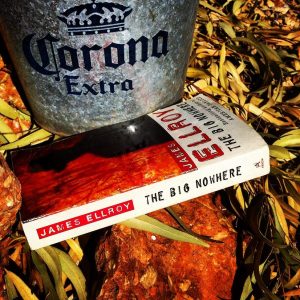
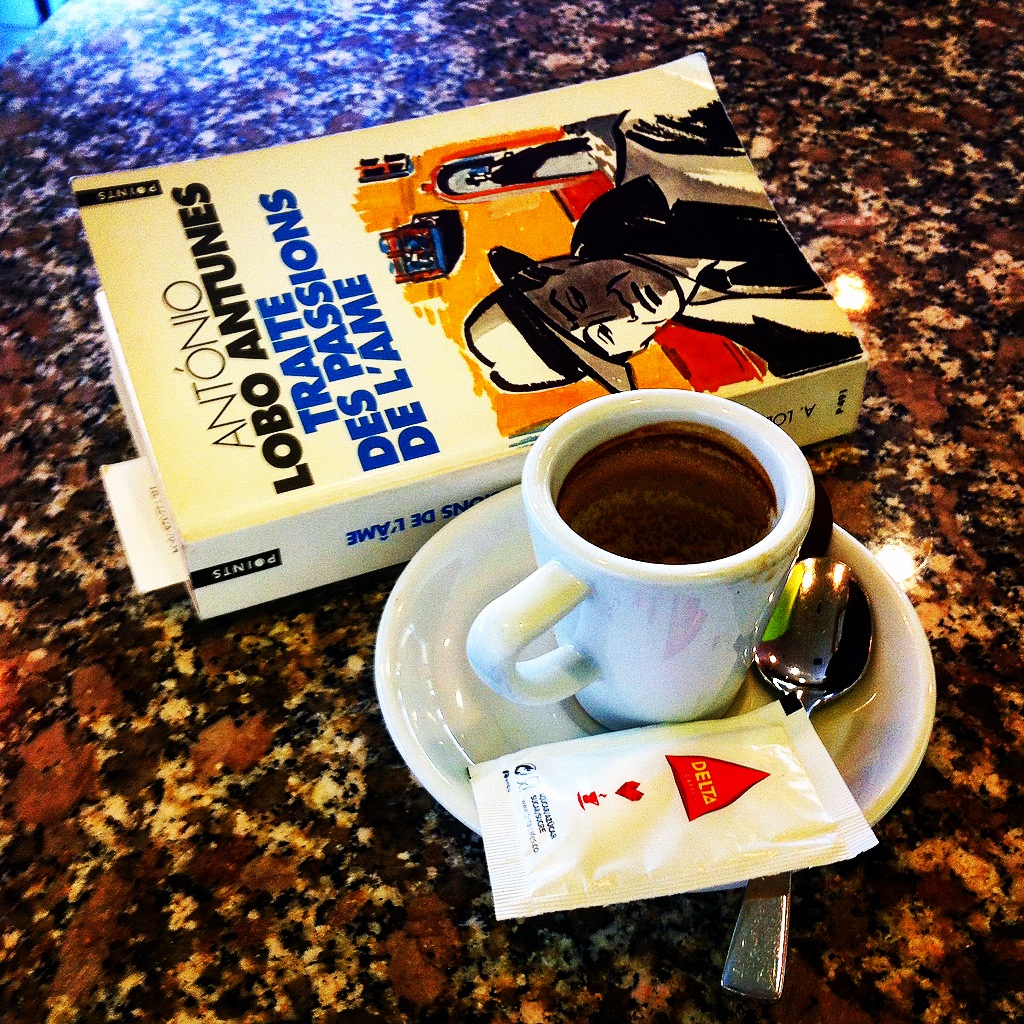 fou. L’avenir radieux lui semble promis, mais il finit en minable agent d’assurance et en révolutionnaire de pacotille. Et il y a le fils du fermier, employé par le grand-père du fils de bonne famille. Malgré les barrières sociales, les deux enfants jouent et grandissent ensemble.
fou. L’avenir radieux lui semble promis, mais il finit en minable agent d’assurance et en révolutionnaire de pacotille. Et il y a le fils du fermier, employé par le grand-père du fils de bonne famille. Malgré les barrières sociales, les deux enfants jouent et grandissent ensemble.